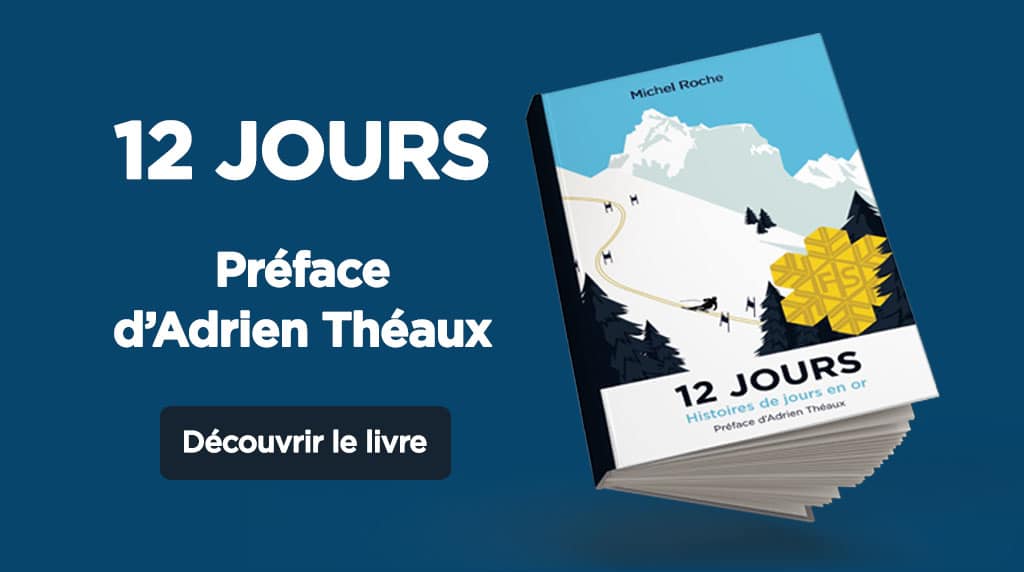Durant l’été, plusieurs articles-enquêtes publiés par Le Monde ont secoué et ébranlé le ski français. Avocate en droit du sport, Me France Roche décrypte les procédures judiciaires et disciplinaires qui s’appliquent en cas de harcèlement moral ou de violences sexuelles dans le milieu sportif. Entre rôle du parquet, obligations des fédérations et nouvelles responsabilités issues de la loi Abitbol, France Roche nous éclaire sur les mécanismes qui doivent protéger les victimes.
Le dépôt d’une plainte est souvent perçu comme la première étape d’un parcours judiciaire en cas de harcèlement. Est-ce toujours le cas ?
Oui, on pourrait le penser. Mais ces dernières années, on a observé une libération de la parole (dans les médias ou via l’édition) qui peut constituer la première étape pour la victime avant de franchir le pas du dépôt de plainte.
J’ajoute qu’une autre voie, de plus en plus utilisée par les victimes ou les témoins, consiste à faire un signalement sur la plateforme « Signal-Sports » mise en place par le Ministère des Sports en décembre 2019. Ce signalement déclenche une alerte officielle pouvant mener à une enquête administrative ou disciplinaire.
Concrètement, comment dépose-t-on une plainte en France ?
Il existe plusieurs façons de déposer plainte, mais la plus courante reste de se rendre personnellement au commissariat de police ou à la gendarmerie.
On peut aussi passer par un avocat, qui déposera soit une plainte simple, généralement auprès du parquet (Procureur de la République), soit une plainte « avec constitution de partie civile » (si la plainte de la victime a été classée sans suite). Une telle plainte oblige le Juge d’instruction à rouvrir le dossier.
Quelles sont les modalités, les délais et les précautions à prendre pour qu’une plainte soit recevable ?
La plainte doit être déposée par la victime elle-même ou par une personne ayant un intérêt à agir : le parent ou le représentant légal si un mineur est concerné. Et évidemment avec le concours possible d’un avocat qui le(s) représente.
Les délais dépendent de plusieurs paramètres : la gravité de l’infraction (délit ou crime) et l’âge de la victime.
En matière de harcèlement, notre code pénal prévoit divers délits (harcèlement moral – qu’il s’agisse au travail ou dans la sphère conjugale ou familiale -, harcèlement sexuel, harcèlement scolaire, et cyberharcèlement).
Le délai de prescription du harcèlement simple, c’est-à-dire le délai maximum pour porter plainte, est de six ans à compter des faits. Mais si la victime est mineure, et qu’il s’agit de faits à caractère sexuel, le délai ne court qu’à compter de sa majorité et peut être porté à 12 ans, voire jusqu’à 30 ans en cas de circonstances aggravantes.
Pour les crimes sexuels le délai de prescription est plus long : 20 ans pour un majeur ou 30 ans à compter de la majorité pour un mineur.
Dans l’affaire de harcèlement sexuel dans le ski révélée cet été par le Monde, le parquet d’Albertville a ouvert une enquête préliminaire tandis que le ministère des Sports a saisi la direction départementale jeunesse et sport de Savoie. Comment s’articulent ces différentes initiatives ? Quelles sont les actions respectives du parquet et de l’administration ?
Vous évoquez le parquet et le représentant de l’état dans le département. En réalité il n’y a pas deux mais trois entités à même de prendre des décisions dans ce cas de figure.
La justice (Le parquet) bien sûr qui ouvre une enquête, et met en branle l’action publique pour faire cesser un trouble et juger un coupable d’infraction.
L’État ensuiteau niveau départemental c’est-à-dire le préfet et ses services (DD de la Cohésion sociale et de la Protection des Populations, Service Départemental à la Jeunesse à l’Engagement et aux Sports) dont la finalité est non seulement, comme le parquet, de protéger la sécurité publique, mais encore de prévenir les risques graves pour les mineurs et pratiquants dans un cadre sportif ; ce sont des mesures de police administrative.
Le préfet peut donc en effet prendre des mesures d’urgence (par voie d’arrêté, valable 6 mois et renouvelable) comme un arrêté d’interdiction administrative d’exercer.
Enfin, les Fédérations qui disposent d’un pouvoir disciplinaire et administratif interne leur permettant de prendre des sanctions disciplinaires visant des licenciés (sportifs ou éducateurs) (ex : avertissement, suspension de licence, interdiction d’exercice des fonctions au sein de la fédération, amendes sportives exclusions) en fonction des règlements disciplinaires édictés par elles-mêmes. Elles visent à maintenir la discipline et la sécurité au sein de la fédération.

Communiqué de la Fédération Française de Ski du 23 juillet
Les différentes mesures sont indépendantes. Cela signifie que chaque autorité est maître de décider telle ou telle mesure dans la sphère de ses propres compétences, mais ce sont aussi des mesures complémentaires dans la lutte contre les violences sexuelles dans le sport afin – et c’est bien naturel – que les victimes se sentent entendues et protégées.
Dans l’affaire révélée par Le Monde, plusieurs skieuses ont dénoncé des faits de harcèlement sexuels mais l’une d’entre elle a porté plainte pour agression sexuelle.
Désormais on parle plus généralement de « violences sexuelles et sexistes » dans le sport.
Les révélations journalistiques – comme celles publiées par Le Monde – peuvent-elles être utilisées par la justice ?
Naturellement une enquête journalistique ne remplace pas une enquête judiciaire, mais la justice se saisit systématiquement des révélations de la presse dès lors qu’elles paraissent sérieuses et étayées. Cela permet d’ouvrir un dossier, de faire cesser le trouble et de punir les auteurs.
Les révélations journalistiques sont donc précieuses et on peut du reste comprendre que des victimes, effrayées par la machine judiciaire, choisissent de se confier à la presse plutôt qu’à la police ou la gendarmerie pour différentes raisons (stress, peur de ne pas être crues ou et des conséquences d’une plainte pénale, moyens d’investigation différents dont disposent les journalistes…).

L’article du Monde du 26 juillet consacré à des accusations de
harcèlement sexuel sur mineures.
Quel rôle joue le procureur – et plus largement les juridictions pénales ou administratives) dans les affaires de violences sexuelles et sexistes dans le milieu sportif ?
Le rôle du Procureur est de veiller au respect de l’ordre public, en poursuivant les auteurs d’infraction pénale devant les juridictions répressives. Il peut donc à ce titre mener avec le concours de la police et de la gendarmerie des enquêtes pour des faits s’étant déroulés dans le milieu sportif, c’est-à-dire au sein de clubs sportifs affiliées à une fédération ou dans le cadre d’activités dépendants directement d’une fédération (tout ce qui est lié au sport de haut niveau) ou encore dans un établissement sportif. Une fois l’enquête bouclée, il renvoie – s’il l’estime utile – les auteurs présumés devant une juridiction pénale pour y être jugés.
Les juridictions pénales interviendront donc dans un second temps. Elles jouent un rôle à la fois répressif (juger et décider de la peine à infliger) et réparateur (offrir une place à la victime en l’entendant lors des débats et en condamnant l’auteur des faits à l’indemniser de ses préjudices lorsqu’elle s’est constituée partie civile).
Les juridictions administratives seront quant à elles plutôt saisies par un licencié de club en cas de contestation des sanctions disciplinaires infligées par sa fédération (une fois passées les voies de recours internes et la conciliation devant le Comité National Olympique et Sportif Français, en cas d’échec de celle-ci).
Sur le plan légal, comment définit-on le harcèlement sexuel et moral ? Quels éléments concrets permettent de qualifier juridiquement une situation de harcèlement moral dans le sport ?
Le harcèlement est « le fait de se comporter envers une personne par des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de vie se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale ». (article 222-33-2-2 du code pénal)
Le harcèlement sexuel est « le fait d’imposer à une personne, de façon répétée, des propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante. » (article 222-33 du code pénal)
On assimile au harcèlement sexuel le fait d’user de toute forme de pression grave dans le but d’obtenir un acte de nature sexuelle.
Il existe bien sûr des circonstances aggravantes lorsque les faits sont commis :
1° Par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ;
2° Sur un mineur de quinze ans.
Il n’y a en revanche pas d’infraction spécifique dans le sport pour le harcèlement moral. Ce sont les règles du code pénal qui s’appliquent mais cela est suffisant pour poursuivre des comportements inadaptés tels les cas dénoncés par les skieuses.
Savoir et ne pas dénoncer : est-ce que le silence face à des faits de harcèlement ou d’agressions sexuelles peut être considéré comme de la non-assistance à personne en danger, voire comme une infraction pénale ?
Ce point a précisément été renforcé ces dernières années en alourdissant les obligations pesant sur les dirigeants de clubs et de fédérations. Aujourd’hui les fédérations et les clubs ont l’obligation de signaler les faits dont ils ont connaissance aux services départementaux de l’Etat en charge des sports, à la cellule « Signal-Sports » et peuvent agir en lien avec la police et la justice.
Depuis la loi du 8 mars 2024, en cas de manquement à ces obligations de la part d’un dirigeant de club, celui-ci encourt lui aussi des mesures administratives d’interdiction d’exercer ses fonctions de dirigeant. S’il emploie ou maintien en emploi un éducateur ne respectant pas les critères d’honorabilité ou s’il ne signale pas aux autorités des comportements dangereux, ce dirigeant encourt personnellement une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.
Avant 2024, il n’existait pas d’obligation spécifique pour les dirigeants sportifs de signaler des comportements à risque des éducateurs.
Toutefois, la non-dénonciation d’un crime ou d’un délit dont toute personne (y compris un dirigeant de club ou de Fédération) a connaissance et constituant un danger grave pour un mineur pouvait déjà engager sa responsabilité pénale.
Le fait de ne pas porter assistance à une personne en danger (ici un mineur victime) comme la non-dénonciation de crimes ou délits graves sont des infractions anciennes (article 223-6 et 434-1 de notre code pénal).
Quelles sont aujourd’hui les obligations légales qui pèsent sur une fédération et sur ses dirigeants dès lors qu’un signalement est reçu ? La loi Abitbol, récemment votée, impose-t-elle de nouvelles responsabilités ?
Dès qu’ils sont informés, Fédérations et clubs doivent eux-mêmes faire suivre le signalement aux autorités compétentes (dans le département, à la police et utiliser signal-sports@sports.gouv.fr )
Les clubs ont aussi depuis la loi du 8 mars 2024 l’obligation de procéder annuellement au contrôle de l’honorabilité des éducateurs sportifs qu’ils sollicitent, salariés ou bénévoles (en consultant le casier judiciaire et le fichier judiciaire automatisé des auteurs d’infraction sexuelles ou violentes, le FIJAIS).
Une Fédération informée de faits de cette nature, doit s’assurer de la mise à l’écart de l’éducateur le temps des investigations (en sollicitant le Préfet qui a le pouvoir de prendre une mesure administrative conservatoire de suspension à effet immédiat) et engager en son sein une procédure disciplinaire, avant même l’issue de l’enquête pénale.
Elle peut donc également suspendre, exclure de manière temporaire ou définitive le mis en cause dans le cadre de cette procédure disciplinaire interne (qui prend plus de temps et qui peut être contestée par l’intéressé jusque devant les Tribunaux administratifs).
La loi Abitbol, adoptée le 8 mars 2024, peut-elle s’appliquer à des faits survenus avant son entrée en vigueur ?
En matière pénale, il n’y a pas de rétroactivité. La loi Abitbol ne s’applique pas aux faits antérieurs à son entrée en vigueur. Mais attention : pour les condamnations définitives inscrites au Fichier Judiciaire National Automatisé des Auteurs d’Infractions Sexuelles ou Violentes, l’interdiction d’exercer s’applique ! (Même si ces condamnations n’apparaissent plus au bulletin n°2 du casier judiciaire).
Donc les dirigeants doivent se séparer et ne pas employer ces personnes.
De plus, la loi fonctionne pour des condamnations prononcées à l’étranger et équivalentes à des infractions françaises.
Ainsi, bien que la loi ne soit pas rétroactive en général, elle a des mécanismes légaux qui peuvent concerner des faits antérieurs inscrits dans des fichiers judiciaires spécifiques.
Quels sont aujourd’hui les délais de prescription pour dénoncer des faits de harcèlement moral, de harcèlement sexuel ou d’agression sexuelle ?
La loi du 3 mars 2018 a allongé les délais de prescription des infractions sexuelles.
- Pour les Crimes sexuels sur majeurs la prescription est désormais toujours de 20 ans à compter des faits.
- Pour les Crimes sexuels sur mineurs la prescription n’est plus de 20 mais de 30 ans désormais à compter de la majorité de la victime (qui peut donc porter plainte jusqu’à ses 48 ans).
- Pour les Délits sexuels sur majeurs la prescription est passée de 3 ou 6 ans à 12 ans.
- Enfin, pour les Délits sexuels sur mineurs la prescription est passée de 10 ou 20 ans à 12 ou 30 ans à compter de la majorité (la durée est plus longue s’il y a des circonstances aggravantes comme si la victime a moins de 15 ans au moment des faits)
De plus, depuis 2021 la protection des victimes est renforcée avec le principe de prescription glissante : La commission d’une nouvelle infraction sexuelle sur un mineur avant la fin du délai de prescription des premiers faits prolonge la prescription de ces faits antérieurs jusqu’à la date de prescription du nouveau fait.
Dans l’affaire révélée par Le Monde, la FFS s’est constituée partie civile. Quels sont les enjeux d’une telle décision, tant pour la Fédération que pour les victimes elles-mêmes ?
La constitution de partie civile est ouverte à toute personne qui se considère comme victime, y compris les personnes morales. Cela signifie donc que la FFS se considère comme telle et entend obtenir réparation.
Il lui appartient d’établir qu’elle subit un préjudice causé par l’infraction, mais il est en général admis par la Cour de Cassation pour des faits de cette nature, laquelle retient l’atteinte aux intérêts matériels et moraux de la discipline et admet donc parfaitement cette constitution de partie civile.
Une Fédération sera toujours légitime à rechercher la protection de ses licenciés ou combattre l’atteinte à l’intérêt collectif qu’elle représente.
L’enjeu pour elle est d’obtenir cette reconnaissance et le cas échéant des dommages intérêts pour le préjudice subi.
Ce droit est du reste inscrit dans le Code du sport.
Pour les victimes, la constitution de partie civile de la Fédération ne change rien. Elles doivent de toute façon agir individuellement pour faire valoir leurs droits.
A propos de Me France Roche
Me France Roche est avocate au barreau de Chambéry depuis 1997. Elle s’est formée au droit du sport et se consacre désormais uniquement à cette matière.
Elle conseille les athlètes et les clubs sportifs en France et à l’étranger, et les défend aussi devant les Tribunaux et les instances disciplinaires.
Me France Roche est également Avocate Mandataire Sportif, c’est-à-dire qu’elle accompagne les athlètes professionnels dans tous les aspects liés à leur carrière, dont la négociation des contrats avec leurs partenaires.
Pour contacter Me France Roche : avocat@franceroche.fr ou depuis son site internet : www.franceroche.fr